Les échographies dans le diagnostic de l’endométriose, ce que les couples infertiles doivent savoir
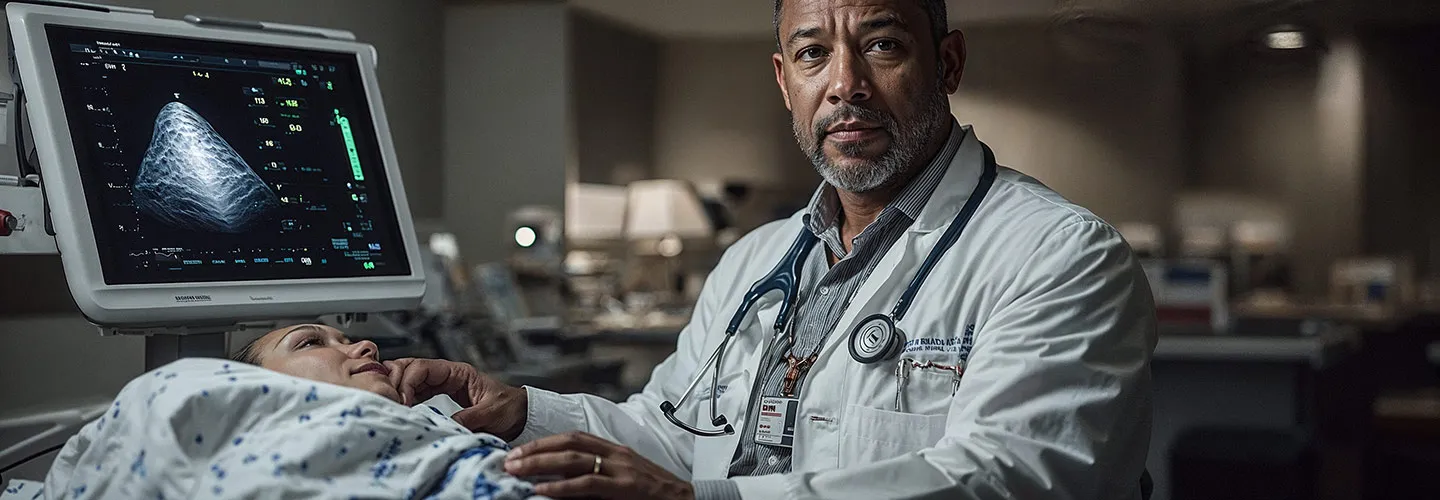
Les échographies dans le diagnostic de l’endométriose : ce que les couples infertiles doivent savoir
L’endométriose est une affection gynécologique complexe qui touche des millions de femmes dans le monde. Caractérisée par la présence de tissu endométrial en dehors de l’utérus, elle se traduit par des douleurs pelviennes, des règles abondantes et, dans de nombreux cas, par l’infertilité. Pour les couples confrontés aux défis de l’infertilité, comprendre comment cette maladie est évaluée est une étape cruciale dans la recherche de solutions. L’échographie, outil d’imagerie non invasif, joue un rôle central dans cette démarche, en fournissant des informations essentielles sur l’extension et la localisation des lésions.
Une approche non invasive au cœur du diagnostic
L’échographie repose sur l’utilisation d’ondes sonores pour visualiser les structures internes du corps. Deux techniques principales permettent d’évaluer l’endométriose :
-
L’échographie transabdominale
Méthode : Le transducteur est placé sur l’abdomen, offrant une vue d’ensemble des organes pelviens.
Avantages et limites : Elle permet une première évaluation générale, mais sa résolution est parfois insuffisante pour détecter les lésions fines ou infiltrantes. -
L’échographie transvaginale (ETV)
Méthode : Un petit transducteur est inséré dans le vagin pour obtenir des images de haute résolution de l’utérus, des ovaires et des structures adjacentes.
Avantages : Cette technique est privilégiée pour la détection de l’endométriose, grâce à sa capacité à révéler des anomalies subtiles et des lésions en profondeur. Des techniques complémentaires, telles que la sonovaginographie (introduction d’une petite quantité de gel dans le fornix postérieur), améliorent encore la précision de l’examen.
Dans certains cas particuliers, comme la suspicion d’atteinte intestinale, l’échographie transrectale peut également être utilisée pour compléter l’exploration.
Une démarche systématique en quatre étapes
Pour standardiser l’examen échographique et améliorer la détection de l’endométriose, le groupe international IDEA (International Deep Endometriosis Analysis) a mis au point une approche en quatre étapes. Cette méthode vise à assurer une évaluation exhaustive et cohérente, facilitant ainsi le diagnostic et la planification thérapeutique.
1. Examen de routine de l’utérus et des annexes
Objectif :
- Rechercher les signes classiques de l’endométriose, notamment la présence d’endométriomes, et identifier d’éventuels signes d’adénomyose.
Comment :
- Le praticien examine l’utérus, les ovaires et les structures environnantes pour détecter des masses ou des anomalies de texture.
- Les endométriomes se présentent typiquement sous la forme de kystes ovarien à aspect homogène, décrits comme « en verre dépoli ».
2. Identification des marqueurs d’adhérences
Objectif :
- Détecter la présence d’adhérences, conséquences fréquentes de l’endométriose, qui peuvent modifier la mobilité des organes pelviens.
Comment :
- L’examen vise à observer la position des organes : une rétroflexion utérine ou des ovaires fixés de manière anormale peuvent être des indices forts.
- La détection d’adhérences est essentielle, car elles peuvent contribuer à la douleur et compliquer la chirurgie ainsi que les traitements de fertilité.
3. Recherche du « sliding sign »
Objectif :
- Vérifier la mobilité relative des organes pelviens pour identifier d’éventuelles adhérences dans le cul-de-sac de Douglas.
Comment :
- En temps réel, le praticien observe la glisse entre l’utérus, les ovaires et le rectum.
- Normalement, ces organes doivent se mouvoir librement ; une absence de « sliding sign » est suggestive d’une fixation due à des adhérences.
4. Recherche des nodules d’endométriose infiltrante profonde (EIP)
Objectif :
- Détecter les nodules infiltrants, particulièrement dans les zones difficiles à explorer, comme les ligaments utérosacrés, le tissu péri-rectal ou les parois intestinales.
Comment :
- L’examen se concentre sur la détection de zones hypoechogènes, c’est-à-dire des zones apparaissant plus sombres à l’échographie, qui indiquent souvent la présence de tissu endométrial infiltrant.
- Ces nodules peuvent être irréguliers et s’étendre profondément dans les structures, rendant leur détection cruciale pour orienter le traitement chirurgical.
Cette approche en quatre étapes permet d’obtenir une cartographie précise de l’extension de la maladie. En identifiant non seulement les endométriomes mais aussi les adhérences et les lésions infiltrantes, le médecin peut élaborer une stratégie thérapeutique personnalisée, adaptée à la gravité de la pathologie et aux besoins spécifiques de la patiente, notamment dans le cadre des traitements de fertilité.
Signes échographiques évocateurs d’endométriose
Au-delà de cette démarche systématique, plusieurs signes échographiques peuvent évoquer l’endométriose :
-
Les endométriomes :
Aspect : Kystes aux contours bien définis, généralement uniloculaires ou parfois multiloculaires, avec un contenu homogène rappelant un « verre dépoli ».
Importance : Leur présence est souvent corrélée à une atteinte sévère et à une infertilité associée. -
L’endométriose infiltrante profonde (EIP) :
Aspect : Nodules hypoechogènes aux contours irréguliers, notamment dans les ligaments utérosacrés, la vessie ou le tissu intestinal.
Importance : Ces lésions peuvent être à l’origine de douleurs chroniques et compliquer la prise en charge chirurgicale. -
Les adhérences et la distorsion anatomique :
Aspect : Mobilité réduite des organes, absence du « sliding sign », voire rapprochement anormal des ovaires (« kissing ovaries »).
Importance : Elles témoignent souvent d’une atteinte étendue et peuvent impacter directement la fertilité. -
Les anomalies des trompes de Fallope :
Aspect : Apparition de structures allongées et serpentines, parfois avec des cloisons incomplètes.
Importance : Ces modifications peuvent perturber le passage des ovocytes et ainsi contribuer à l’infertilité.
Il convient de souligner que, bien que l’échographie soit un outil précieux, elle présente certaines limites. Notamment, les lésions superficielles restent souvent invisibles et l’examen dépend fortement de l’expertise du praticien. Dans ces cas, l’IRM ou la laparoscopie (qui demeure le diagnostic de référence avec confirmation histologique) peuvent compléter l’évaluation.
En conclusion
Pour les couples confrontés à l’infertilité, l’évaluation de l’endométriose constitue une étape déterminante. L’échographie, par sa nature non invasive et son aptitude à révéler une variété d’anomalies – des kystes caractéristiques aux adhérences en passant par les nodules infiltrants – permet une première appréciation indispensable de l’étendue de la maladie. L’approche systématique en quatre étapes, développée par le groupe IDEA, offre quant à elle une méthode rigoureuse pour guider le diagnostic et la planification thérapeutique.
Si vous suspectez une atteinte endométriosique, il est essentiel d’en discuter avec votre spécialiste afin de bénéficier d’un bilan complet. Une détection précoce et une prise en charge adaptée peuvent significativement améliorer les chances de conception et la qualité de vie des patientes.
Pour en savoir plus sur l’endométriose et ses implications sur la fertilité, consultez vos professionnels de santé et les ressources spécialisées disponibles auprès d’institutions de référence.
Le contenu a été créé par Dr. Senai Aksoy et approuvé médicalement.
